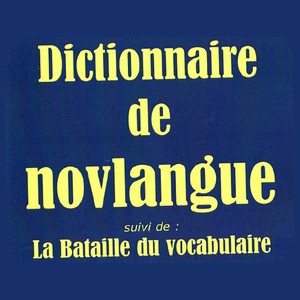L’Education nationale prend toujours un aussi grand plaisir à utiliser son jargon « pédagogique ». Rassurons-nous, les nouveaux programmes ont été présentés comme « plus simples et plus lisibles ». Il n’est pas sûr encore que tous vont les comprendre et les interpréter correctement sans faire appel au nouveau dictionnaire de novlangue (cf George Orwell et 1984). Plus surprenant encore quand on n’ose parler de Big brother !
Les nouveaux programmes de cycle 4, en particulier, nous donnent de savants exemples de simplicité, dont voici quelques extraits.
C’est en éducation physique et sportive (cycle 4) que les expressions sont les plus sympathiques.
- Compétence : « Créer de la vitesse, l’utiliser pour réaliser une performance mesurée, dans un milieu standardisé. »
Repères de progressivité : « Se repérer dans l’espace athlétique et accepter les déséquilibres provoqués. S’organiser pour construire une continuité spatiotemporelle d’actions. Optimiser les trajectoires, les forces exercées et les vitesses produites, anticiper les actions à venir pour agrandir l’espace et raccourcir le temps. » (page 22)
Pour dire de façon plus compliquée : courir - Compétence : « Se déplacer de façon autonome, plus longtemps, plus vite, dans un milieu aquatique profond standardisé. »
Repères de progressivité : « Construire la capacité à « traverser » l’eau avec le moins de résistance en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. » (page 22)
Traduction : nager - Compétence : « Interpréter seul le jeu pour prendre des décisions et rechercher le gain d’un duel médié par une balle ou un volant. » (page 23)
- Compétence : « Vaincre un adversaire en lui imposant une domination corporelle symbolique et codifiée. » (page 23)
- Histoire-géographie : « Produire des messages à l’oral et à l’écrit » (page 5)
Interprétation : après l’étude de documents, on n’est plus dans la rédaction d’un devoir, mais d’un message (tweet ou texte ?) - « Aller de soi et de l’ici vers l’autre et l’ailleurs » (page 17).
Comme chacun l’aura compris, il s’agit de la phrase d’introduction concernant les langues étrangères et régionales. - …
Et le mot spiralaire
Chacun sait qu’il pourrait être opposé à linéaire. Ce mot spiralaire est cité dans l’étude de la langue, où l’on explique que : « Ces notions sont abordées de manière spiralaire tout au long de l’année, en s’appuyant sur les réalisations langagières des élèves. » (page 16)
Mais également dans l’éducation aux médias et à l’information : « L’acquisition des compétences de l’EMI est mise en œuvre tout au long du cycle, selon les projets interdisciplinaires (voir en particulier les objets d’étude interdisciplinaires inscrits au programme) et organisée de façon spiralaire, chaque compétence présentée ici pouvant être réinvestie d’une année à l’autre selon les projets. »
Pour conclure sur ce mot, selon Sylvie Queval, philosophe de l’éducation, la notion de pédagogie « spiralaire », inventée en 1960, a « vite rencontré un large écho chez les pédagogues, qui trouvent dans la métaphore de la spirale une façon juste d’exprimer qu’apprendre est un processus continu qui suppose une reprise constante de ce qui est déjà acquis ».
Laissez votre esprit vagabonder dans les projets de programmes mis en lien dans notre article sur la réforme des programmes, d’autres expressions peut-être encore plus savoureuses s’y trouvent !